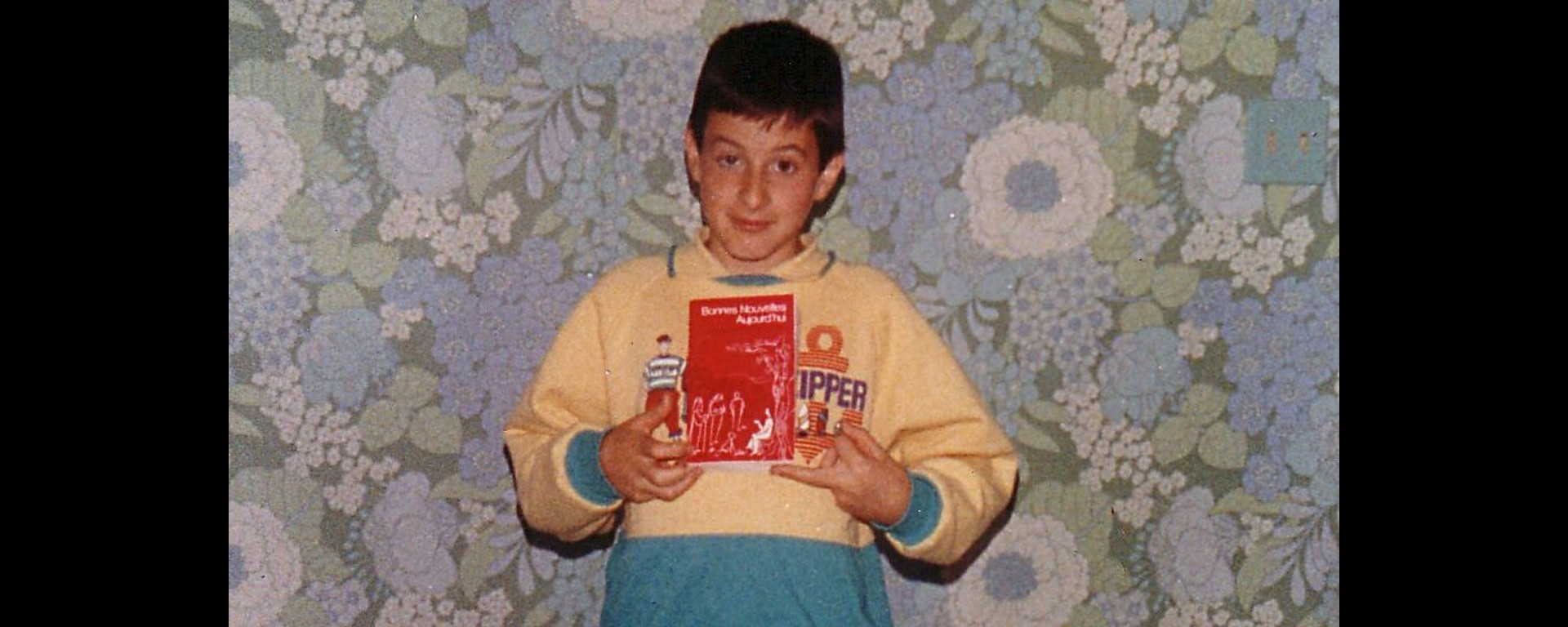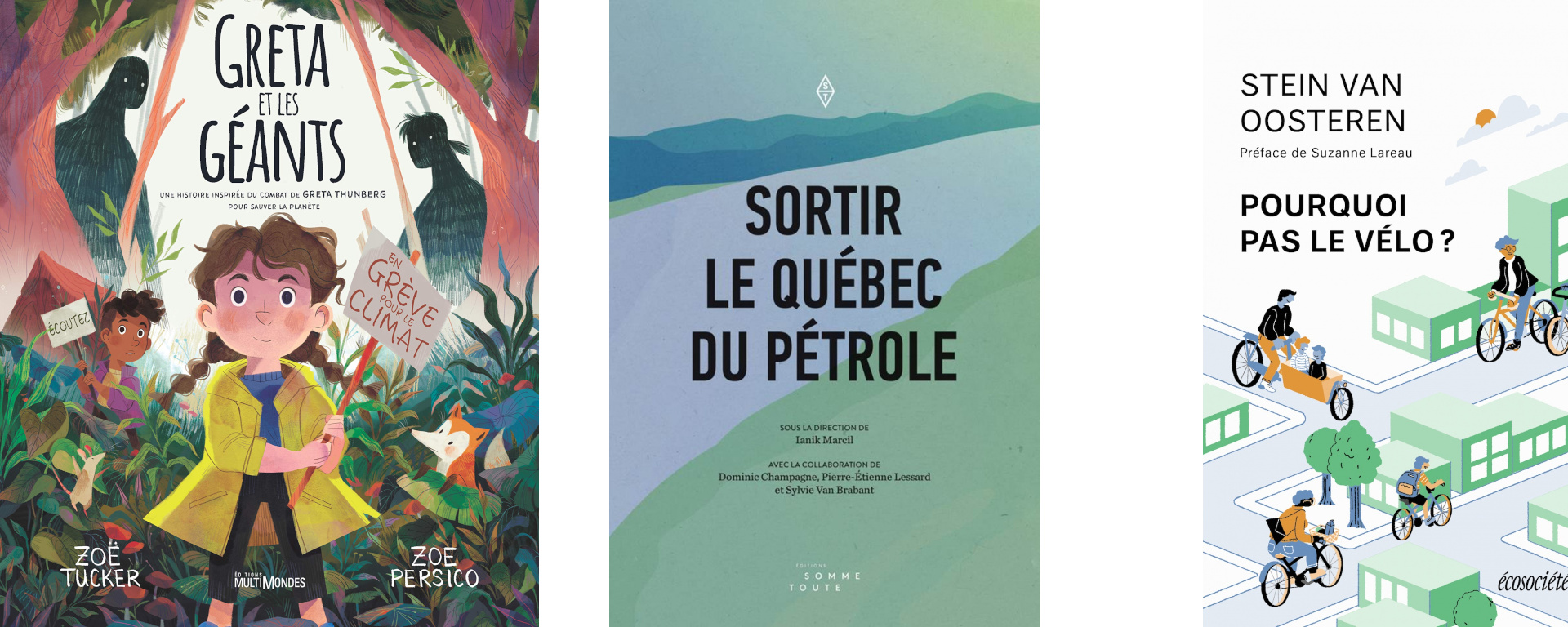Comme piéton, comme cycliste et comme automobiliste, j’avoue avoir été un peu exaspéré d’entendre, une fois de plus, la ritournelle selon laquelle « changer les pancartes de vitesse ne changera rien ». Or, tout indique le contraire. Les données issues de plusieurs villes montrent que l’abaissement de la limite de vitesse, même modeste, a un effet réel et mesurable sur la sécurité.
À Edmonton, une étude de 2023 a montré qu’abaisser la limite de 50 à 40 km/h a entrainé une baisse de 25 % des collisions et de 30 % des blessures graves ou mortelles. En Australie, la réduction des vitesses sur les routes locales a permis de réduire de 55 % les collisions graves et mortelles. Et à Toronto, la stratégie Vision Zero, qui combine limites plus basses, radars et aménagements, a mené à une baisse de 65 % des collisions graves ou mortelles sur les rues passées à 30 km/h.
Ces chiffres ne sortent pas de nulle part : ils confirment un principe physique élémentaire. Plus la vitesse est basse, plus le champ de vision s’élargit, plus la distance de freinage diminue, et moins les impacts sont violents. Diminuer la vitesse, c’est bon pour les piétons, pour les cyclistes… mais aussi pour les automobilistes eux-mêmes, qui risquent moins d’être impliqués dans des collisions couteuses, stressantes ou tragiques.
La mesure la plus simple et la plus juste
La plupart des rues résidentielles de Sherbrooke n’affichent aucune limite : la vitesse de 50 km/h s’y applique « par défaut ». Changer cette règle globalement, pour faire du 40 km/h la norme, serait la mesure la plus simple à mettre en œuvre. Contrairement aux dos d’âne ou aux rétrécissements de chaussée, qui coûtent cher et ne peuvent être installés partout, une révision de la limite de vitesse agit sur l’ensemble du territoire, du jour au lendemain.
Et même si certains conducteurs continuent à dépasser les limites, l’effet global reste positif. Celui qui roulait à 70 km/h dans une zone de 50 roulera sans doute à 60 km/h dans une zone de 40. Celui qui se tenait à 55 ralentira à 50 ou 45. La moyenne baisse, et avec elle, les risques. C’est simple à comprendre, et c’est ce qu’observent les villes qui ont osé franchir le pas.
L’époque a changé
On cite souvent l’étude de la professeure Lynda Bellalite (Université de Sherbrooke) pour relativiser l’impact de ces changements. Réalisée en 2010, elle concluait qu’un simple changement de signalisation ne faisait baisser la vitesse moyenne que de 2 km/h. Mais cette étude date d’une époque où peu de villes misaient sur une approche intégrée, combinant signalisation, aménagements et communication.
Depuis, plusieurs municipalités canadiennes ont fait le saut et leurs résultats sont nettement plus convaincants. Bellalite elle-même a d’ailleurs insisté plus tard sur la notion de « vitesse crédible » : quand une rue est conçue pour inviter naturellement à ralentir, les automobilistes s’adaptent. À Sherbrooke, plusieurs chantiers récents vont justement dans ce sens : rues plus étroites, trottoirs élargis, avancées de bordures. Ces transformations, combinées à une limite plus basse, rendent le respect des règles plus intuitif.
Une question de culture collective
Réduire la limite à 40 km/h, ce n’est pas un gadget politique. C’est une étape d’un changement de culture. Pendant des décennies, nos routes ont été pensées pour maximiser la vitesse et la fluidité, pas la sécurité ni la convivialité. Aujourd’hui, la priorité s’inverse : ce sont nos milieux de vie et notre quiétude qu’il faut protéger.
Oui, il faudra du temps pour que les habitudes changent. Mais chaque panneau, chaque aménagement, chaque geste compte. Ralentir, ce n’est pas perdre du temps : c’est un acte de civisme, c’est redonner de la valeur au temps qu’on partage. Et ça, c’est aller beaucoup plus loin que 40 km/h.